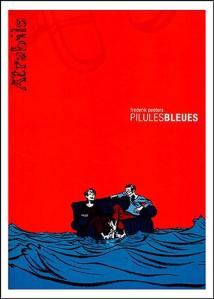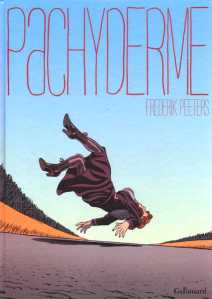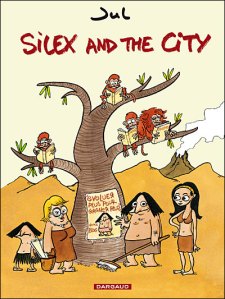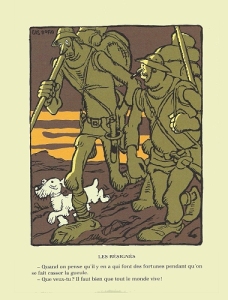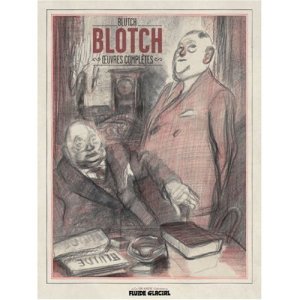La réécriture des grands mythes en Bd et la tentation documentaire
Les deux séries que je souhaite vous faire découvrir aujourd’hui sont plutôt récentes, et donc facilement trouvables dans le commerce ou en médiathèque. Il s’agit de la série Martha Jane Cannary de Christian Perrissin (scénario) et Matthieu Blanchin (dessin), dont le second opus est sorti en octobre dernier chez Futuropolis, et Arthur, une épopée celtique de Jérôme Lereculey (dessin), David Chauvel (scénario) et Jean-Luc Simon (couleurs), que Delcourt a édité de 1999 à 2006. Cet article fait en quelque sorte suite au précédent article sur Jules Verne dans la BD, puisqu’il s’agit là aussi de deux adaptations littéraires, mais dont la particularité est de tenter de revenir aux sources de deux grands mythes, la légende arthurienne et Calamity Jane, une des nombreuses figures de l’épopée du grand Ouest américain. Pour cela, les auteurs ont eu recours à de la documentation, procédé certes courant chez les auteurs de BD, et en particulier de BD historique, mais à une documentation rare et peu connue. Une manière pour eux de relire à la fois le mythe dont ils traitent, mais aussi les codes graphiques et littéraires des deux genres dans lesquels ils se sont engouffrés : le western d’un côté et l’heroic-fantasy de l’autre.
La face cachée de l’Ouest américain

Le beau projet de Christian Perrissin et Matthieu Blanchin chez Futuropolis a connu une bonne reconnaissance critique qui lui a assuré une certaine publicité et a très vite affirmé Martha Jane Cannary comme un album marquant. Christian Perrissin, le scénariste, a depuis plusieurs années un projet d’adaptation de Lettres de Calamity Jane à sa fille, un ouvrage publié et traduit en français par Payot et Rivages en 1997. C’est avec le dessinateur Matthieu Blanchin qu’il va le mettre sur pied. En janvier 2008 paraît le premier tome de la série et le projet est alors dévoilé dans toute son ambition : trois tomes d’environ 120 pages chacun, au catalogue de Futuropolis. Ce premier tome, Les années 1852-1869, reçoit le prix Ouest-France – Quai des Bulles au festival de Saint-Malo à l’octobre 2008. En 2009, il est dans la sélection officielle du Festival d’Angoulême et est recompensé d’un « prix Essentiel ». Le parcours idéal de la série ne s’arrête pas là, puisque, au festival de Saint-Malo 2009, une exposition entière lui est consacrée pour présenter le travail des deux auteurs, au moment même où une autre exposition a lieu dans une librairie parisienne… D’où un deuxième tome évidemment très attendu.
On comprend la démarche des auteurs : imaginer la vie de Calamity Jane, de son vrai nom Martha Jane Cannary, en s’appuyant sur des sources précises, et en particulier les Lettres qu’elle aurait écrites à sa fille. Rappelons rapidement que Calamity Jane, née en 1852 et morte en 1903, fait partie des légendes de l’Ouest américain, ces personnages héroïques dont la vie est à la lisière de la fiction et la réalité et dont, finalement, on sait très peu de choses. Elle aurait laissé deux écrits autobiographiques (dont les Lettres connues aux Etats-Unis depuis 1941), mais leur authenticité est contesté par certains historiens, notamment à cause de la dimension mythomane du personnage qui enjolivait elle-même sa vie. Le temps a renforcé l’aura du personnage et sa vie a été surtout pris une allure de légende, diffusée par colportage dans des brochures bon marché, puis au XXe siècle dans des films, romans, séries…
L’album de Perrissin et Blanchin est donc un objet peu courant dans la BD contemporaine, à mi-chemin entre la reconstitution historico-légendaire (les auteurs disent bien « imaginer » et non reconstruire la vie de Calamity Jane) et la fiction d’aventure. Quand au scénario, il s’écarte volontairement d’une vision héroïque et cherche tout au contraire à se rapprocher de la réalité de la vie d’une femme américaine à la fin du XIXe siècle. Nous sommes bien loin de la vision traditionnelle de l’Ouest diffusé par les westerns…
Aux origines du mythe arthurien

Il y a loin, me direz-vous, de Calamity Jane au roi Arthur… Pas tant que ça, vous répondrai-je, car Arthur fait également partie de ces figures héroïques dont l’historicité est douteuse mais dont la légende a connu une importante diffusion. Certes, l’historicité de Calamity Jane n’est pas contesté mais, comme chez Arthur, la fiction prend une place considérable dans sa vie, et on peut parler de personnages légendaires dont la vie est devenu un roman. J’en profite d’ailleurs pour conseiller aux Parisiens de se rendre l’exposition La légende du roi Arthur qui se tient actuellement à la Bibliothèque nationale de France, sur le site François Mitterrand. Elle est consacrée à la diffusion de la légende arthurienne depuis le Moyen Age et en raconte l’origine, les grands héros et les évolutions au moyen de la très belle collection de manuscrits de la BnF. Ne soyez pas effrayés par les vieux papiers, vous en apprendrez beaucoup sur un des mythes les plus importants du monde occidental. Et le site internet de l’exposition est très bien fait ( http://expositions.bnf.fr/arthur/ ).
Mais je m’égare, car c’est de la série Arthur de Jérôme Lereculey et David Chauvel que je souhaitais vous parler. Série commencée en 1999 chez Delcourt (dont je saluais dans cet article l’ambition de renouveler la fantasy), elle s’est achevée en 2007. Les deux auteurs, tous deux bretons, avaient déjà travaillés ensemble sur une série policière intitulée Nuit noire parue chez Delcourt de 1996 à 1997. Avec Arthur, ils changent de registre pour se plonger dans le récit d’aventure épique fait de batailles, d’amours impossibles, et de magie. En neuf albums, chacun consacré à un héros et à ses aventures, ils tissent ainsi un aspect peu connu de la légende arthurienne : sa dimension païenne et primitive telle qu’elle apparaît dans des legendes galloises avant la réécriture du mythe arthurien au XIIe siècle par Chrétien de Troyes. La série commence avec la naissance du curieux Myrddin (Merlin) et s’achève avec la trahison de Medrawt (Mordred).
Vers les nouvelles sources du mythe
Dans Arthur comme dans Martha Jane, l’enjeu est de s’attaquer à un mythe connu et de le renouveler en cherchant d’autres sources que celles traditionnellement utilisées et connues. Ces deux grands mythes occidentaux, la légende arthurienne et la conquête de l’Ouest américain se sont retrouvés durant tout le XXe siècle, au gré de romans, de films, de BD, figées dans des images et des récits qui, parce qu’ils sont connus de tous, ont valeur de mythe. Les auteurs des deux albums ont cherché à créer de nouvelles images à plaquer sur ces mêmes noms. De fait, on ne reconnaîtra pas la légende arthurienne classique dans la série éditée par Delcourt. A l’exception d’Arthur, qui a gardé son nom, les autres héros ont leurs noms gallois ; pas de table ronde, de quête du Graal ni d’épée dans le rocher dans cette légende païenne. Si les structures de base des récits tels qu’on les connaît sont là, ce ne sont pas les mêmes héros, et ils n’ont pas la familiarité que peuvent avoir les Lancelot, Guenièvre, Perceval et Galaad d’oeuvres contemporaines comme les films Excalibur, Sacré graal ou la série Kaamelott. Notre perception de ce mythe est en fait conditionnée par la compilation qu’en a fait Thomas Malory au Xve siècle, principale source pour les relectures ultérieures jusqu’à nos jours (http://expositions.bnf.fr/arthur/expo/salle3/08.htm ). Quant à Calamity Jane, notre vision est forcément orientée sur la grande époque du western qui, dès les années 1930 et jusqu’aux années 1960 a figé une vision du grand Ouest américain fait de cow-boys, d’indiens, de duels d’honneur et de fusillades incessantes. Ce n’est pas du tout ce que les auteurs de Martha ont voulu dépeindre ; ils se sont concentrés sur les aspects plus quotidiens de la vie dans l’Ouest : les travaux de la ferme, les parcours longs et périlleux des convois, la condition des femmes. Il n’y a pas de beau cow-boy ténébreux, de princesses de saloon, de gangsters impénitents. Calamity Jane elle-même est une jeune femme débrouillarde mais néanmoins fragile, bien loin de l’image que les fans de Lucky Luke peuvent en avoir.
On l’aura compris, c’est en allant chercher d’autres sources que nos auteurs ont pu proposer cette vision alternative de grands mythes. Ce qui est d’autant plus intéressant, c’est qu’ils assument parfaitement cette démarche documentariste et ne la cachent pas derrière le récit. Dans les deux cas, une voix narrative s’élevant au-dessus des cases vient rappeler qu’il s’agit d’un conte. Employer un narrateur tantôt pour raconter les trous de l’histoire, tantôt pour expliciter une scène ou une situation n’est pas très courant dans la BD contemporaine (exception faite de l’autobiographie). Cela témoigne de la mise en avant de la pratique de l’auteur, comme s’il désossait sont récit et en montrait la structure. La figure du conteur est d’ailleurs présente dans les deux séries, soit par les nombreuses légendes parallèles racontées par Merlin dans Arthur, soit par les exploits que s’invente Martha Jane Cannary elle-même. La sincérité de l’auteur-documentariste est poussée jusqu’au bout puisque les deux séries commencent par un avertissement des auteurs quant à leur démarche : « Cet album est le premier d’une série ayant pour ambition de retranscrire le cycle arthurien dit primitif (…) il s’appuie en grande partie sur des textes et légendes galloises (…) Les auteurs ayant pour souci de ne pas se faire passer pour les créateurs originaux de ces histoires… » et « Pour imaginer ce qu’a pu être la vie de Martha Jane Cannary en essayant d’inventer le moins possible… ». Dans cette optique, l’auteur est un passeur dont le but est de revenir à une authenticité des faits ou de la légende. Une bibliographie (assez longue et spécialisée dans le cas d’Arthur) annonce au public les sources utilisées pour le travail de reconstitution. Le fait de travailler à partir de la documentation n’est pas rare chez les auteurs de BD. En revanche, il n’est pas courant de présenter son oeuvre comme directement issue de cette étude préalable. C’est en cela que, à mon sens, la démarche des auteurs d’Arthur et de Martha Jane sont tout aussi proches de celle d’un documentariste et historien que de celle d’un auteur de BD.
Relire des mythes masque un autre enjeu : se mesurer au poids de la tradition graphique de trois grands genres très codifiés du neuvième art, le western, l’heroic-fantasy et la BD historique. Les deux albums témoignent de deux attitudes opposées : là où les auteurs d’Arthur se confrontent directement aux codes de la fantasy et de la BD historique, ceux de Martha Jane affirment par un graphisme et une narration originales leur spécificité face au western graphique. On sait que Jérôme Lereculey a appris la BD auprès de Patrice Pellerin, auteur des 7 vies de l’épervier, un classique de la BD historique. Son empreinte se ressent derrière le traitement réaliste des personnages d’Arthur qui, au fil des albums, va vers un dessin velouté, propre et très bien maîtrisé. Cette maîtrise qui se ressent par exemple dans les scènes de combat qui deviennent de grandioses illustrations ; il y a asurément chez Lereculey un fort classicisme, un goût du Beau, qui plait ou non, mais qui, pour ma part m’attire l’oeil. J’y trouve encore d’autres traces d’une beauté classique : une gestion dynamique des cadrages, un rythme permettant d’équilibrer scènes de paysage, combats, portraits rapprochés, des couleurs contrastées posées au bon endroit… Et bien sûr, le goût pour la reconstitution historique des armes, armures, habitats, avec, par moment (voir les couvertures, mais pas seulement), une tentative de faire allusion à l’art ornemental et figuratif celtique, ou du moins à ce qu’on en connaît. Arthur sublime ainsi la BD historique et emprunte à l’heroic-fantasy le rythme épique.
Tout au contraire, Blanchin et Perrissin ont voulu s’éloigner des codes traditionnels du western graphique tel qu’il s’exprime dans des séries sérieuses (Jerry Spring, Blueberry, Buddy Longway) ou comiques (Lucky Luke, Les tuniques bleues, Chick Bill). Il y a d’abord cette voix narrative revenant au début de chaque chapitre, s’écartant parfois face à l’action, revenant à l’improviste pour faire progresser l’histoire, qui fait de Martha Jane un album au rythme plus littéraire où le texte prend parfois le pas sur l’image. Mais surtout il y a le dessin si particulier de Matthieu Blanchin qui ne ressemble à rien de connu jusque là dans le western graphique : ni réalisme forcé, ni style humoristique franco-belge. Le dessin varie en fonction des plans, se faisant tantôt plus soigné, tantôt plus synthétique. L’emploi du lavis renforce encore la singularité de ce dessin, et, pour reprendre les termes de Loleck sur le site Du9 : « Dans ses lavis et ses clair-obscurs, il parvient même à évoquer le sépia des vieilles photos de l’Ouest. Une sorte de brume flotte autour de ses dessins, comme si chaque planche émergeait du passé, comme si chaque dessin nous laissait jeter un regard sur la jeunesse de l’Amérique. » . Je pense alors à une autre série relisant le western, Gus de Christophe Blain. Mais dans Gus, il s’agit davantage d’une parodie sur les codes traditionnels, alors qu’ici, ces codes sont complètement ignorés. L’aventure de Calamity Jane se fait alors moins romanesque mais plus intime, et tout aussi captivante.
Pour en savoir plus :
Sur Martha Jane Cannary et la légende Calamity Jane
http://www.matthieublanchin.net/
Un article intéressant sur les Lettres de Calamity Jane : http://clio.revues.org/index269.html
Et quelques critiques sur la série : http://du9.org/Martha-Jane-Cannary-les-annees et http://www.actuabd.com/Martha-Jane-Cannary-Les-annees
Sur Arthur, une épopée celtique et la légende arthurienne :
Une interview de Jérôme Lereculey : http://www.auracan.com/Interviews/Lereculey/Lereculey.html
Le site de l’exposition de la BnF : http://expositions.bnf.fr/arthur/