Nous, lecteurs assidus de bande dessinée, avons souvent un rapport à nos lectures qui remontent à l’enfance. D’abord parce que la bande dessinée fait partie des lectures enfantines traditionnelles sans être liée à l’école et à l’apprentissage scolaire de la lecture, ce qui lui donne une saveur bien différente. Ensuite parce que, contrairement au cinéma ou à la littérature, les œuvres de bande dessinée lues pendant l’enfance sont souvent celles qui ont influencé des auteurs de bande dessinée adulte, sans compter le fait que des albums d’Astérix ou de Gaston se relisent volontiers (alors que j’ai quelque doute sur la qualité de revisionnage de Casper le gentil fantôme !). Une familiarité se crée, avec l’impression d’être dans un même univers de lecture, et le passage de la bande dessinée pour enfants à la bande dessinée pour adultes est sans doute un choc moins grand que le passage du Roi Lion à Reservoir Dogs. En cela, les lectures d’enfance sont sans doute fondatrices de la façon dont on continue, après l’enfance, à lire et apprécier la bande dessinée…
Nous voici arrivé au dernier article de la série… J’ai oublié de nombreux albums lus pendant mon enfance, des découvertes ponctuels hors des chemins décrits dans les articles précédents, mais je voulais absolument terminer en évoquant comment se sont conjugués découverte de la bd alternative et fin de l’adolescence.
Le temps de l’alternatif
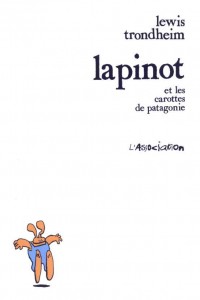 Après une enfance passée des classiques franco-belges et disneyens aux fantaisies héroïques de l’imaginaire adolescent des années 2000, j’ignorais tous des fluctuations toutes contemporaines de mon média préféré. La notion même de « bande dessinée alternative » m’était inconnue, et je ne me doutais pas des tensions que traversait alors une industrie en pleine reconstruction. Car pendant que je grandissais, les nouveaux alternatifs des années 1990, nés quelques années après moi, grandissaient aussi. Je traversais l’adolescence à ce moment précis où quelques succès comme ceux de Persepolis de Marjane Satrapi ou du Journal de Fabrice Neaud mettaient en lumière les éditeurs alternatifs de cette nouvelle génération d’auteurs qui parvenaient à introduire leurs univers chez des éditeurs installés jusqu’ici bien frileux envers les expérimentations éditoriales de la scène indépendante. Cette « assimilation » au sens biologique du terme, a pu être dénoncée par certains qui ont vu l’édition mainstream profiter d’un succès qu’elle n’avait pas initié. Sans doute oublient-ils que ce processus aura aussi permis à de jeunes lecteurs biberonnés chez Dargaud, Dupuis, Delcourt et Casterman de rencontrer des auteurs qu’ils n’auraient jamais su trouver par eux-mêmes, ou en tout cas pas aussi tôt.
Après une enfance passée des classiques franco-belges et disneyens aux fantaisies héroïques de l’imaginaire adolescent des années 2000, j’ignorais tous des fluctuations toutes contemporaines de mon média préféré. La notion même de « bande dessinée alternative » m’était inconnue, et je ne me doutais pas des tensions que traversait alors une industrie en pleine reconstruction. Car pendant que je grandissais, les nouveaux alternatifs des années 1990, nés quelques années après moi, grandissaient aussi. Je traversais l’adolescence à ce moment précis où quelques succès comme ceux de Persepolis de Marjane Satrapi ou du Journal de Fabrice Neaud mettaient en lumière les éditeurs alternatifs de cette nouvelle génération d’auteurs qui parvenaient à introduire leurs univers chez des éditeurs installés jusqu’ici bien frileux envers les expérimentations éditoriales de la scène indépendante. Cette « assimilation » au sens biologique du terme, a pu être dénoncée par certains qui ont vu l’édition mainstream profiter d’un succès qu’elle n’avait pas initié. Sans doute oublient-ils que ce processus aura aussi permis à de jeunes lecteurs biberonnés chez Dargaud, Dupuis, Delcourt et Casterman de rencontrer des auteurs qu’ils n’auraient jamais su trouver par eux-mêmes, ou en tout cas pas aussi tôt.
Lors de la série d’entretiens menés auprès de jeunes docteurs et doctorants, je me suis rendu compte que ce parcours de lecteur étaient extrêmement courant chez les amateurs de bande dessinée de ma génération et, il faut l’avouer, de ma classe socio-culturelle. On commençait avec l’une ou l’autre entrée « classique » de la bande dessinée pour enfants, et, au détour de l’adolescence, on découvrait d’autres éditeurs dont la dimension, justement, « alternative », répondait si bien aux émois de la révolte personnelle contre l’autorité qui caractérise cette période de la vie de chacun. Découvrir la bande dessinée alternative était une façon de se démarquer, à la fois de la société, de ses contemporains, de ses parents, des normes culturelles, et pour certains du monde capitaliste. Dans mon souvenir, il n’y avait pas, alors, sur les étagères des librairies et des bibliothèques, de rayons spécialisés « alternatifs », ou alors des rayons minuscules, presque honteux, où l’on rangeait tout ce qui n’avait pas le format d’un album traditionnel. J’ignore si aujourd’hui où la distinction entre édition mainstream et édition alternative n’est plus aussi évidente les jeunes lecteurs ressentent cette découverte d’auteurs « autres » avec autant de force.
Car pour moi la bande dessinée alternative a réellement signifié mon passage à l’âge adulte. Cette relation s’est construite sur le mode du passage, et la corrélation entre les deux est si évidente qu’elle a conditionné mes pratiques pour les années à venir ; il est très rare, à présent, que je fasse l’acquisition d’un album Dargaud, Dupuis, ou Delcourt, alors même que ces éditeurs composent l’essentiel de ma bibliothèque d’enfant, et que je suis tout à fait conscient qu’ils éditent aussi des œuvres qui me plairaient entièrement. Sans l’ouverture d’esprit de ces éditeurs que j’écarte à présent, je n’aurais peut-être jamais vécu l’édition alternative comme une porte de sortie de l’enfance. Il y a derrière cela sans doute une forme de snobisme, d’élitisme éclectivore qui, selon les sociologues, caractérise les pratiques culturelles des nouvelles classes moyennes cultivées, et en un sens ce déterminisme socio-culturel me désole autant qu’il m’effraie. Mon parcours de lecteur était-il si prévisible ? Alors je préfère me raccrocher aux souvenirs de deux passeurs, qui ont été, en un sens, les moteurs de mon évolution personnelle.
Le voyage en Patagonie
Le premier de ces passeurs ne sera une surprise pour personne et je me permets de le dévoiler d’emblée : il s’agit de Lewis Trondheim. Je n’exagère pas en disant que Trondheim m’a appris à lire de la bande dessinée en adulte… Mais pour cela il me faut revenir un peu sur l’enfance.
 Car c’est bien à cause de la persistance de l’enfance dans son œuvre que j’ai commencé à lire Trondheim. Un jour, sans que je ne sache exactement pourquoi, une image lointaine resurgit dans ma mémoire. J’étais alors adolescent et je me souvenais très bien que cette image me revenait de l’enfance, et de la lecture d’Okapi. Il y avait des bandes dessinées dans Okapi, L’Inspecteur Bayard et Touffu, mais rien qui ne m’emballait vraiment. Dans mon souvenir, je ne lisais pas la revue pour ses dessins, mais pour le rédactionnel. Alors pourquoi cette image ? Je me souvenais vaguement de personnages animaliers, de couleurs vives, d’un professeur, de gags très drôles… Et l’envie me prit alors de retrouver ces sensations, alors même que j’étais incapable de me remémorer le nom de la série, ou de l’auteur. C’est ainsi que commença ma chasse à Trondheim, car c’était lui.
Car c’est bien à cause de la persistance de l’enfance dans son œuvre que j’ai commencé à lire Trondheim. Un jour, sans que je ne sache exactement pourquoi, une image lointaine resurgit dans ma mémoire. J’étais alors adolescent et je me souvenais très bien que cette image me revenait de l’enfance, et de la lecture d’Okapi. Il y avait des bandes dessinées dans Okapi, L’Inspecteur Bayard et Touffu, mais rien qui ne m’emballait vraiment. Dans mon souvenir, je ne lisais pas la revue pour ses dessins, mais pour le rédactionnel. Alors pourquoi cette image ? Je me souvenais vaguement de personnages animaliers, de couleurs vives, d’un professeur, de gags très drôles… Et l’envie me prit alors de retrouver ces sensations, alors même que j’étais incapable de me remémorer le nom de la série, ou de l’auteur. C’est ainsi que commença ma chasse à Trondheim, car c’était lui.
La traque durant longtemps. Je feuilletais sans succès mes vieux numéros d’Okapi relégués à la cave ; je furetais dans les librairies à la recherche de l’image ou d’une de ces semblances. Internet existait si peu à l’époque que je ne pouvais retrouver facilement le nom. Finalement, je finis par avoir un flash en tombant sur cette série au nom ridicule, Les formidables aventures de Lapinot. C’était ce dessin. C’était ce trait que je cherchais depuis plusieurs mois. La chasse était terminée, même si je ne retrouvais jamais vraiment l’histoire d’origine.
Ma première histoire de Lapinot fut Pour de vrai. J’avais longtemps hésité devant les différentes couvertures et avait opté pour celle-ci qui me semblait le plus relever d’un fantastique que je recherchais à l’époque dans toutes mes lectures (je découvrais Buzzati, Lovecraft, Cortazar…). La première impression fut plutôt décevante. Je ne comprenais pas tout, je prenais quelques pans d’intrigue en cours de route, et j’étais désarçonné par le côté pince-sans-rire de certains des gags, ainsi que par l’ancrage dans le quotidien plus profond que je ne l’aurais cru. Mais je m’accrochais. J’en lisais un deuxième, un troisième, et finalement toute la série. Elle avait déjà quelques années quand je la découvrais et venait de se terminer. Qu’à cela ne tienne, j’avais découvert là un auteur que j’aimais énormément, justement parce qu’il me rappelait un peu des sensations visuelles de lecture de l’enfance, avec ses personnages animaliers et ses dehors comiques et inconséquents, mais dans des récits troublants qui posaient, en arrière-plan et sans outrance provocatrice, des questions d’adultes. J’ai un souvenir particulier de Vacances de printemps, scénarisé par Frank Legall, où les échos des rêveries et rixes enfantines du jeune Lapinot victorien se brisaient face à la réalité du monde. Ils étaient d’autant plus précieux pour moi que je les achetais moi-même, avec mon argent de poche, à la librairie Album de la ville, et les partageais avec un de mes amis les plus proches. Peut-être aussi, pour la première fois, je m’identifiais pleinement à un personnage d’adulte qui justement, n’en pouvait plus d’être un enfant.
Je découvris bientôt que ma quête trondheimienne n’était pas réellement terminée. Par Internet, ou par les pages « du même auteur », je ne sais plus, je fus mis au courant de l’existence d’un « épisode mythique » de Lapinot, qui avait comme nom mystérieux Lapinot et les carottes de Patagonie. On parlait d’un livre gigantesque, de près de 500 pages, tout en noir et blanc… D’un exercice de style insensé. Je finis par le trouver chez Album, dans ces rayonnages d’alternatifs où dormaient des albums en exemplaires uniques. Je vis une qualité dans cette rareté. Comme il coûtait plus cher que les autres, je me le fis offrir pour un Noël ou un anniversaire.
Je ne m’attendais absolument pas à la lecture de Lapinot et les carottes de Patagonie. Autant la série Lapinot me plaisait par sa familiarité, ses références si lisibles et universelles au western, à l’art contemporain, au fantastique… Autant cet album hors norme (plus de 500 pages! Tout en noir et blanc!) ne ressemblait à rien de ce que je connaissais. C’était passionnant. Ainsi y avait-il une issue hors de l’album cartonné qui constituait alors mon principal horizon d’attente graphique… Ainsi la bande dessinée ne servait-elle pas qu’à s’amuser, elle était capable de se penser elle-même… Ainsi pouvait-on réaliser et publier ça en bande dessinée. Mais qui étaient donc les éditeurs qui permettaient de dépasser de telles bornes ? Alors je me lançais dans l’alternatif…
Un combat ordinaire
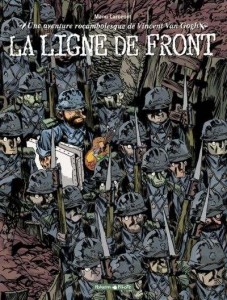 J’en viens alors au second des passeurs qui fut Manu Larcenet. Et peut-être est-il un peu abusif de le considérer comme faisant partie de cette « édition alternative » ? Je découvrais d’abord Larcenet comme un des moteurs de la collection « Poisson Pilote » de Dargaud que j’appris tout de suite à reconnaître comme un sceau de qualité. Il y avait publié de nombreux albums que j’appréciais énormément : Le Retour à la Terre, Les Cosmonautes du futur, Les Entremondes et la série Une aventure rocambolesque de… sur laquelle je reviendrais. J’ignorais tout de son passage à Fluide Glacial, et je ne découvrirais l’incroyable Bill Baroud, cette merveille d’humour parodique, que quelques années plus tard. Et puis j’avais une quinzaine d’années quand commença à paraître Le combat ordinaire, chez Dargaud également. Des fantaisies de Poisson Pilote à la biographie du photographe névrosé Marco, il y avait tout un monde. C’en devenait presque suspect, ce passage soudain d’un registre à l’autre (et je ne savais rien alors de la production de Larcenet aux Rêveurs de Rune). Je lisais Le combat ordinaire avec un étonnement immense qui poussait ma curiosité vers cette zone où la bande dessinée ne servait pas qu’à raconter des histoires, mais pouvait aussi raconter des vies, des émotions, des idées. Je me demandais pourquoi cet amuseur notoire d’un coup se mettait à évoquer la politique, le racisme, la dépression. Le combat ordinaire me semblait trop radical ; je craignais d’y voir une posture d’auteur, une forme de prétention que je ne voulais pas reconnaître, qui relevait pour moi d’une littérature du moi ronflante et plein d’apitoiements. N’avais-je pas sauté une étape ?
J’en viens alors au second des passeurs qui fut Manu Larcenet. Et peut-être est-il un peu abusif de le considérer comme faisant partie de cette « édition alternative » ? Je découvrais d’abord Larcenet comme un des moteurs de la collection « Poisson Pilote » de Dargaud que j’appris tout de suite à reconnaître comme un sceau de qualité. Il y avait publié de nombreux albums que j’appréciais énormément : Le Retour à la Terre, Les Cosmonautes du futur, Les Entremondes et la série Une aventure rocambolesque de… sur laquelle je reviendrais. J’ignorais tout de son passage à Fluide Glacial, et je ne découvrirais l’incroyable Bill Baroud, cette merveille d’humour parodique, que quelques années plus tard. Et puis j’avais une quinzaine d’années quand commença à paraître Le combat ordinaire, chez Dargaud également. Des fantaisies de Poisson Pilote à la biographie du photographe névrosé Marco, il y avait tout un monde. C’en devenait presque suspect, ce passage soudain d’un registre à l’autre (et je ne savais rien alors de la production de Larcenet aux Rêveurs de Rune). Je lisais Le combat ordinaire avec un étonnement immense qui poussait ma curiosité vers cette zone où la bande dessinée ne servait pas qu’à raconter des histoires, mais pouvait aussi raconter des vies, des émotions, des idées. Je me demandais pourquoi cet amuseur notoire d’un coup se mettait à évoquer la politique, le racisme, la dépression. Le combat ordinaire me semblait trop radical ; je craignais d’y voir une posture d’auteur, une forme de prétention que je ne voulais pas reconnaître, qui relevait pour moi d’une littérature du moi ronflante et plein d’apitoiements. N’avais-je pas sauté une étape ?
Et cette étape s’incarna dans une toute autre lecture, plus périphérique mais finalement bien plus inspirante. Suivant le Poisson Pilote je m’intéressais à la série Une aventure de rocambolesque de…, et particulièrement à l’épisode consacré à Vincent Van Gogh pendant la première guerre mondiale, intitulé La ligne de front. Il venait juste de sortir et cette idée d’anachronisme du peintre à l’oreille coupée resurgissant pendant le premier conflit du siècle m’inspirait davantage que les états d’âme de Marco. Dans le fond, je ne pouvais pas me détacher de la fiction et de l’humour venus des lectures d’enfance, et c’était là ce que j’attendais de cet épisode. Si j’y trouvais ma dose d’aventure et de comédie absurde comme sait en livrer Larcenet, j’y trouvais aussi d’autres surprises, des surprises qui, comme à la lecture du Combat ordinaire, venaient semer le trouble, mais un trouble enrobé et bien plus supportable, plus humble en un sens. Il y avait cette bascule du récit qui, de parodie de récit de guerre dont les accents devaient bien me rappeler mes Tuniques bleues préférées, devenait d’un seul coup un conte philosophique éthéré. Cette histoire d’arbre des morts, de mère de la guerre, et puis ces oiseaux, ces engoulevents aux crânes de monstres dessinés un peu partout, instillant un fantastique alléchant, et finalement transportant l’histoire au-delà de son point de départ. Ce n’était plus de Vincent Van Gogh ou de la première guerre mondiale dont il était question, c’était de l’humanité et de la mort. Des profondeurs se creusaient à chaque page. Et puis toujours ces dessins d’oiseaux, ces dessins précis, naturalistes, ornithologiste, que venaient-ils faire ici ?
À travers Trondheim et Larcenet, c’était ma conception de la bande dessinée qui évoluait. Ils m’avaient ouvert des mondes, à la fois esthétiquement et éditorialement parlant. Via Trondheim je m’intéressais plus largement à l’Association ; via Larcenet je découvrais Fluide Glacial. Tous ces dessins si différents de mes albums d’enfants qui, déjà, s’éloignaient. Décidément, il me fallait aller plus loin…