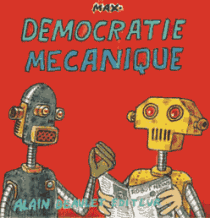Remontant le temps de ma bibliothèque de bande dessinée, j’ai voulu aujourd’hui mettre en avant deux oeuvres dont on parle peu et qui, pourtant, compte pour moi parmi les petits trésors des années 2000. Sans être d’incroyables chefs-d’oeuvre, ni des jalons marquants de leur époque, elles méritent de ne pas être oubliées. Je vais vous parler de Démocratie mécanique de Max (2000 – Alain Beaulet) et de Quel est le propos ? de Laurent André (2005 – L’Association). Puis, si vous avez le courage de me lire jusqu’au bout, j’évoquerais des questions plus larges et plus actuelles…
La vie des robots
J’ai déjà eu l’occasion d’évoquer Max, dessinateur ayant fait ses débuts dans la presse underground des années 1970 (Metal Hurlant, Zoulou, L‘Echo des savanes) et que la maison d’édition l’Association a eu la bonne idée de faire réemerger dans les années 2000 en éditant le singulier hommage à la SF et au fantastique référencé qu’est Sombres ténèbres. Démocratie mécanique est comme un extra de Sombres ténèbres, un « hors série » qui développe, en quelques saynètes d’une page chacune, l’univers créé dans la série. Il ne s’agit plus de développer un récit de genre débridé aux inspirations multiples mais de se poser un instant dans le quotidien de la « démocratie mécanique ».
De quoi se compose cet univers ? Dans un futur lointain, l’humanité a disparu et la Terre est devenue une planète de robots. Toutefois, ces robots ont des traits et des comportements bien humains, et, finalement, sous des masques d’acier, Max propose une peinture amusée de la société contemporaine. Tout l’intéret de Démocratie mécanique est dans le contraste entre l’étrangeté des images qui nous sont proposées et la familiarité des situations. On se trouve donc dans un monde où, comme tout terrien moyen, les robots manifestent dans la rue, se jugent les uns les autres à l’emporte-pièce, friment dans les galeries d’arts, s’excitent devant l’érotisme de revues de mécanique avancée, et où les concepts d’indécence, de discrimination, de peur, de dépression nevreuse, sont toujours bien présents. C’est le malaise des grandes villes et de la banlieue que peint Max, par exemple dans cette très belle scène d’angoisse urbaine au charme rétro, comme figé dans les années 80.
Curieusement, le style graphique sobre et presque simpliste du dessinateur colle très bien à ce décalage de lecture. Mais la grande trouvaille de l’album par rapport à la série et certainement sa mise en couleurs. Là où le noir et blanc servait bien le fantastique de Sombres ténèbres, le traitement de la couleur participe ici au jeu entre familiarité et étrangeté. La palette de Max est extrêmement variée. Elle sert bien sûr à singulariser chaque robot pour en faire un individu. Mais elle sert aussi à représenter des émotions, en particulier dans ces cieux entre deux teintes si singuliers. La double page où un motard-robot chante Born to be wild au milieu d’un décor lunaire allant du violet au vert est une vraie victoire de l’imaginaire.

Un « Easy rider » robotisé sur la Lune : toute la poésie référencée et l’inventivité des couleurs de Max
Une autre part du charme de ce court opus est dans l’incessante valse des références et citations. L’une des trouvailles de Max (qui valait déjà dans la série principale) et que, si cet univers est futuriste, peuplé de robots et de monstres, les nouveaux habitants métalliques de la Terre n’ont en rien oublié la culture du passé, bien au contraire. Cette culture, c’est bien entendu celle de l’auteur lui-même, et là le jeu devient délicieux tant il rappelle comment les créations se nourrissent les unes les autres. Les robots de Max sont tous fans des Ramones, de Star Wars, des vieux romans de SF, de la série Futurama, de comic books rétros… Les obsessions de l’auteur tournent à l’érudition quand il convoque R.U.R. de Karel Capek, une des premières oeuvres de science-fiction mettant en scène des robots. Alors bien sur on pourra trouver cette avalanche de références un peu lourdes, l’univers de Max est archi-référencé, mais la modestie du propos, du style, et des situations montrent qu’il s’agit surtout d’hommages multiples d’un grand fan de culture underground, tout média et époque confondu.
« Il va faire très très beau »
Avec Laurent André, on bascule dans un tout autre registre. Difficile de décrire les très curieuses pages de Quel est le propos ? qui a tout d’un OVNI graphique incompréhensible de prime abord. Le dessin, sale, peut être rebutant ; le « propos », comme le titre l’annonce, plutôt abscons, et pourtant rarement un album ne m’aura fait autant rire.
Admettons d’abord que l’humour de Laurent André est un humour absurde, un humour de l’à-peu-près, de l’improbable, du décalage constant avec le réel. C’est un art de la juxtaposition qui, en même temps, ne se veut pas intellectuel comme peut l’être un Goossens. Au contraire, comme Max, Laurent André fait preuve d’une forme d’humilité face à son art et face à son lecteur.
Alors par où commencer ?
Une description formelle ? Chaque page est une sorte de fil de réflexions mêlant dessins et texte manuscrit en gros caractères, le texte étant presque ici réduit à l’état d’image, ou du moins utilisé pour son impact visuel, comme une façon de composer autrement la page. La page de bande dessinée est ici réduite à une marginalia hors norme où l’auteur semble nous dire tout ce qui lui passe par la tête.
Un exemple de lecture ? Le meilleur exemple de l’absurde de Laurent André est l’histoire récurrente du zèbre brun et du scout calcaire, deux personnages de Quel est le propos ?. L’histoire est une suite de situations improbables telles que « zèbre brun part en Suède avec une figue et du scotch » ou encore « zèbre brun décide de couler un rhume sur le Reggiani sous cape ». On est proche ici de collages surréalistes et je ne serais pas étonné d’apprendre que l’histoire ait été composée par un système d’écriture à contraintes oulipiennes (ou par une version graphique de l’écriture automatique). Une fois qu’on a lu et apprécié l’histoire du zèbre brun et du scout calcaire, le reste parait presque normal.
L’une des qualités de Laurent André est de parvenir à combiner approximations langagières et graphiques. Un mot en amène un autre et une image génère encore d’autres propos, dans un processus ininterrompu de marabout-bout-de-ficelle qui a à voir avec le flux de la pensée, avec l’automatisme des images mentales qui nous trottent toute la journée dans la tête. En témoignent les multiples flèches qui jalonnent le parcours et sont censées aider le lecteur à s’orienter dans la page. En réalité, elles sont autant de fausses pistes tant la lecture n’a pas de sens, au propre comme au figuré.
Le plus surprenant là-dedans est que, par moment, la juxtaposition finit par créer des effets de sens, imperceptibles, à un niveau infime, comme cette page sur le « paranormal » d’où naît un mystère poétique, comme si les mots et les images eux-mêmes s’étaient liguées pour éviter leur sujet. On croit parfois reconnaître un Claude François tordu, Certains lecteurs de Laurent André s’appuient même sur ces créations pour développer de vastes théories esthétiques sur la nature de la bande dessinée.
Finalement, chacun y trouve son compte, le mien étant surtout une jubilation face à l’inventivité des mots et des images et l’impression d’être face à une distorsion momentanée du réel, bienvenue en des temps où le réel déçoit.
Éloge du mode mineur et de la surproduction
Ce qui m’intéresse aussi dans ces deux livres, c’est qu’ils font tous les deux parti d’un « mode mineur » de la production de bande dessinée de la décennie précédente. Ils sont les éclats dispersés des alternatifs des années 1990 ; en quelque sorte le mouvement inverse du rapprochement entre les gros éditeurs historiques et l’édition alternative puisqu’ils maintiennent ce principe d’une bande dessinée réellement alternative, et indépendante d’un « marché ».
Il suffit de regarder plusieurs indices. D’abord les deux auteurs, qui sont des auteurs rares, voire très rares. Tous deux ont commencé à dessiner dans les années 1980, mais leur production demeure parcimonieuse, surtout celle de Laurent André. Je ne lui connais que deux bandes dessinées, celle-ci et une autre parue dans les années 1980, mais mis à part ça aucune trace d’albums. Il a semble-t-il participé à des revues comme Lapin et R de réel (d’où sont tirées les planches de Quel est le propos ?, nous dit la page de garde), mais sinon pas d’autres traces, et je suis preneur de nouvelles du groupe Facebook « Pour que Laurent André publie une nouvelle BD » créé en 2010. Quant à Max, si sa production graphique est plus visible (aux Humanoïdes Associés dès les années 1980), elle semble se limiter, depuis quelques années, au développement patient de l’univers de Sombres ténèbres, à l’Association.
Tous deux entretiennent d’ailleurs des liens avec la maison d’édition phare de la génération des nouveaux alternatifs. Quel est le propos ? est publié à l’Association, et Laurent André est présenté sur le site comme un « ami de toujours de l’Association ». Si c’est elle qui rééditera Max dans les années 2000, Démocratie mécanique est publié chez un éditeur moins tapageur mais plus ancien, en l’occurrence Alain Beaulet dont le catalogue, d’une grande qualité et d’un éclectisme enthousiasmant, mêle les générations. Nous sommes là encore dans une édition alternative au sens propre, au sens où elle ne suit pas la mode et se développe en marge de la production la plus visible.
Et il me semble bien que ces deux albums ont en commun d’être « à côté » de la bande dessinée. Ce sont deux petits formats, bien loin du 48CC mais aussi du nouveau format « roman graphique » à la mode durant la décennie 2000. Démocratie mécanique a même l’audace de revendiquer un format carré presque rétro, comme une sorte d’édition d’art milieu-de-siècle. Le format de leurs images aussi est à part : ce n’est pas vraiment de la bande dessinée au sens strict, on se rapproche plus de l’illustration, et en même temps les codes du média sont bien là… Finalement, il est clair qu’il est égal aux deux auteurs de savoir s’ils font ou non de la bande dessinée, l’essentiel pour eux étant de dessiner, et ils ont raison.
Ils font de l’underground au sens strict, au sens d’une création « sous la surface », qui ne cherche pas à se rattacher à tout prix à des logiques éditoriales établies. Voilà qui est rafraîchissant.
Si j’évoque le cas de ces deux auteurs en ce moment, c’est pour deux raisons.
D’une part mes goûts de lecteurs me poussent de plus en plus à aller vers la jeune micro-édition (le terme n’est sans doute pas juste pour tous, certains s’étant développés depuis) : les éditions Lapin, Vide Cocagne, Warum, Hoochie-Coochie, Arbitraire, Même pas mal, l’Egouttoir, Jarjille, Onapratut, Tanibis… Ils publient peut-être une quinzaine d’ouvrages par an, permettent de suivre certains auteurs peu connus, ou de suivre la production marginale d’autres auteurs plus connus. Et cette recherche de la marge m’est d’autant plus chère que j’y trouve une qualité exceptionnelle (j’en reparlerai sans doute…), et une grande diversité. Le blog de Maël Rannou, Un fanzine par jour, permet d’apprécier l’historicité de cette production. Tout cela est précieux.
Tout cela est d’autant plus précieux, et c’est mon « d’autre part », à l’heure où j’entends se développer le discours sur la « surproduction », qui se généralise depuis plusieurs années. J’entends bien ce discours : trop d’albums paraissent, on ne peut plus tout lire, les auteurs n’ont plus de quoi vivre et leur situation est, objectivement, désastreuse… Mais je vois aussi que l’idée de « surproduction » peut prendre plusieurs sens. S’il peut être un plaidoyer pour la qualité, contre l’industrialisation de la bande dessinée (mais cette industrialisation existait déjà dans les années 1950, à son échelle…), il peut aussi être une critique de tous ces petits éditeurs qui se lancent et publient, qui des carnets de croquis, qui des recueils d’illustration… Une production qui n’est absolument pas rentable, mais qui est, à mes yeux de lecteur, un vrai trésor. Et je vois là l’effet pervers du discours sur la surproduction : si la surproduction permet de lire des auteurs rares comme Laurent André ou Max, dans des ouvrages qui n’ont rien de rentables, qui ne viennent pas changer la face de la bande dessinée, alors je suis pour la surproduction. Et je ne suis pas parfaitement certain que cette « surproduction » soit la cause principale de la crise, ou en tout cas je m’interroge sur le sens qu’on doit donner à cette antienne.
En attendant, j’espère que vous m’excuserez d’avoir dévié de la création vers la politique, et je vous enjoins tous à profiter de la surproduction pour lire toutes ces perles de la micro-édition, passée, présente ou à venir !