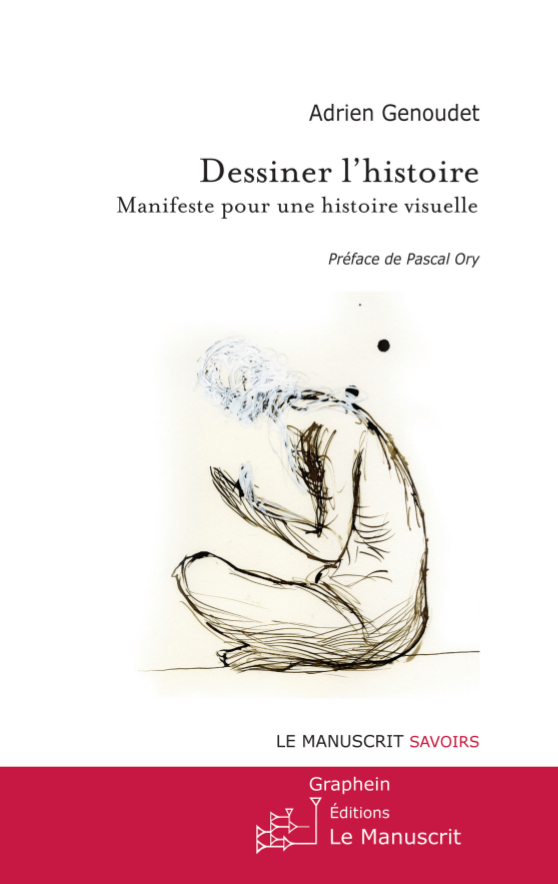Alors d’accord, la bande dessinée devient un objet de plus en plus dynamique à l’université… Mais dans quel but ? A première vue, l’étude de la bande dessinée est bien loin de cette idée d’une recherche scientifique « utile », directement transmissible à la société civile, pour permettre de grandes avancées médicales (en biologie), de mieux comprendre les évolutions politiques à la lumière du passé (histoire), ou encore de faire avancer la cause de modèle économiques alternatifs (économie).
Pourtant, deux parutions récentes de caractères complètement différentes vont m’aider à argumenter dans le sens d’une utilité manifeste de l’étude scientifique de la bande dessinée : un récent article de blog de Patrick Peccate sur les dinosaures et l’ouvrage d’Adrien Genoudet Dessiner l’histoire. Ou comment comprendre la place de la bande dessinée dans la société, c’est aussi mieux maîtriser la culture visuelle des XXe et XXIe siècle.
Le passé des images
Les lecteurs réguliers de ce blog se souviennent peut-être d’une interview d’Adrien Genoudet récemment parue ici. Doctorant travaillant sur le cinéma, ce chercheur se présente comme le promoteur d’une « histoire visuelle » au sein de laquelle la bande dessinée aurait toute sa place. C’est d’ailleurs elle qui est à l’honneur dans son récent ouvrage Dessiner l’histoire, paru aux éditions Le Manuscrit dans une collection, « Graphein », qu’il co-dirige avec Vincent Marie.
Dans cet ouvrage, Genoudet interroge la représentation de l’histoire par la bande dessinée. Son postulat est que le passé est fait d’images créées, utilisées et réutilisées par les créateurs des arts visuels. En analysant les processus d’appropriation des images par les auteurs, on peut reconstruire une sorte de généalogie de l’image. Surtout, pour l’auteur, « ces bandes dessinées [historiques] se donnent à voir, à travers ces différentes pratiques, comme d’excellents lieux d’analyses pour comprendre que le passé est une image composite partagée et à disposition – c’est-à-dire à son tour appropriable« . Des études de ce type ont déjà pu être menées de façon ponctuelles et sur des périodes précises (je pense à la thèse de Vincent Marie, justement). Mais Genoudet ne se limite pas à une étude par trop commune des représentations de telle ou telle époque ou tel ou tel fait dans la bande dessinée ; il passe à l’étape supérieure en cherchant les mécanismes génériques qui, dans la pratique concrète des auteurs, font que le passé est aussi composé d’images construites, déconstruites, reconstruites.
La réflexion d’Adrien Genoudet offre, me semble-t-il, une piste sérieuse pour répondre à notre question initiale sur l’utilité d’une recherche scientifique sur la bande dessinée. Elle met en avant l’idée que la bande dessinée est un média susceptible de capter des images issues d’autres sources et en fait ainsi un outil de « témoignage » historique ayant sa manière propre, déterminée ici, selon l’auteur, par les mécanisme d’appropriation par les auteurs. Ainsi, étudier la bande dessinée (ici dans une perspective d’historien) permet de comprendre quelles images nous retenons du passé, comment nous les déformons, et par conséquence d’éclairer ce qu’on appelle notre « culture visuelle ».
Je ne sort pas le terme de « culture visuelle » de mon chapeau, ni par hasard : le terme désigne une méthode d’analyse culturelle, pluri-disciplinaire, qui passe d’abord par « l’exploration des dimensions visuelles de la culture ». Il a donné son nom à une plateforme de blogs scientifiques assez réputée [http://culturevisuelle.hypotheses.org/a-propos], imaginée par André Gunthert, et qui rassemble, notamment, les blogs d’Adrien Genoudet et Patrick Peccatte. Les chercheurs travaillant dans ce domaine partent du principe que, si la culture écrite a été pendant longtemps la plus visible, la plus étudiée, et considérée comme la plus susceptible de véhiculer des idées et des connaissances, il existe une culture des images qu’il est indispensable de maîtriser, encore davantage à notre époque contemporaine où le visuel occupe une part de plus en plus importante par la conjonction des médias audiovisuels (cinéma, jeu vidéo, télévision, vidéo) et dessinés (bande dessinée). Ils prolongent ainsi des réflexions plus anciennes sur l’histoire de l’image, portées par exemple dès les années 1970 par Michel Melot (les spécialistes me pardonneront de résumer et me corrigeront si besoin). Dans cette logique la bande dessinée trouve une place dans la connaissance de nos sociétés.
Des dinosaures par milliers
Patrick Peccatte fait partie de ces chercheurs en culture visuelle et anime depuis 2010 l’intéressant blog Déjà vu, lié à la galaxie de l’agrégateur « Culture visuelle » d’André Gunthert. Le principe de ses billets est généralement toujours le même : il part d’une trope visuelle pour examiner l’évolution de sa représentation à travers le temps, tous médias confondus. Comme ici sur l’image du « clown malfaisant » [http://dejavu.hypotheses.org/2010], ou là sur le stéréotype de la « statue de la liberté en ruines » : (http://dejavu.hypotheses.org/1609]. Ses réflexions sont généralement passionnantes car il ne se contente pas de mettre en rapport des images visuellement proches : il tente d’expliquer la généalogie qui relie entre elles toutes ces images, et d’en dresser des typologies.
Son dernier article m’intéresse tout particulièrement puisqu’il est consacré à l’image du dinosaure dans les pulps magazine et comic books au XXe siècle. Je ne me risquerais pas à résumer l’article, mais en deux mots, l’auteur, à partir d’une base de données d’images définies par leur source (les objets populaires que sont les pulps et comic books), et leur thème (présence d’un dinosaure à l’image), essaye de comprendre comment l’image du dinosaure a été véhiculé dans ce type de littérature populaire (les exemples viennent surtout d’oeuvres de grande diffusion). Ce travail lui permet d’identifier des tropes visuelles, des stéréotypes, autrement dit des types d’images (ou des types d’utilisation d’images) récurrentes.
Il permet par exemple de dresser des liens entre les représentations des ouvrages de vulgarisation scientifique du XIXe siècle et les représentations dans les bandes dessinées américaines. Il est alors intéressant de voir comment les ouvrages documentaires de Louis Figuier et Camille Flammarion en viennent à nourrir une imagerie de fiction et de divertissement. Pour ma part, c’est l’enseignement le plus intéressant de l’énumération de Patrick Peccatte : comprendre la façon dont les images circulent, soit entre médias différents, soit entre des genres d’objets culturels différents dans leur destination.
Comme le dit l’auteur en conclusion : « le travail décrit ici brièvement montre que l’imagerie des dinos s’inspire en réalité d’un nombre restreint de tropes visuels qui se composent entre eux. ». Les images de bande dessinée ne naissent pas de nulle part mais de ce que les auteurs peuvent avoir sous les yeux à un temps donné.
La démarche choisie par Patrick Peccatte est à la fois une force et une faiblesse de son discours. Je commence par l’aspect négatif. La méthodologie systématiquement employée par l’auteur est d’accumuler de (très) grandes quantités d’images (pour nos dinosaures : 2000) pour en dresser une typologie, chercher les relations historiques ou visuelles, et livrer ainsi le fruit de ses analyses. Ce côté « énumération » rend l’article un peu laborieux à suivre, plus que d’autres de ses articles où l’équilibre entre la liste d’images et la réflexion est suffisant pour ne pas lasser. Ici, pour tout dire, au bout de la vingtième diapo comparative, j’ai un peu abandonné les images pour me concentrer sur le texte.
Mais il va de soi que, sans cette méthode longue et fastidieuse, la force du discours de Patrick Peccatte ne serait pas la même. Mieux encore, il me semble qu’il vient contrebalancer un écueil potentiel de la réflexion menée par Adrien Genoudet dans Dessiner l’histoire : à trop se concentrer sur la démarche d’appropriation par l’auteur, il y a un risque d’oublier que l’image n’est pas que « produite », elle est aussi diffusée. J’ai tendance à penser que l’analyse d’images de masse, diffusées à grande échelle, est au moins aussi pertinente que l’analyse de la pratique individuelle d’auteurs quand il s’agit de comprendre la place des images dans la société. C’est exactement ce que fait Patrick Peccatte, dans une logique extrême inverse : jamais (ou presque) il n’évoque les auteurs de ces images de dinosaures (sauf pour les images d’origine). On pourrait d’ailleurs lui reprocher de contribuer à faire s’équivaloir toutes les images, peu importe leur qualité. Il semble que pour lui, la formation de la culture visuelle passe moins par une appropriation d’auteurs que par la répétition à grande échelle. Il n’en demeure pas moins qu’avec les images de Peccatte, on assiste bien, et aussi de façon frappante, à la formation d’une imagerie du dinosaure dans la bande dessinée.
Je caricature bien sûr volontairement les deux postures pour vous faire comprendre qu’étudier la place de la bande dessinée dans la culture visuelle contemporaine n’est pas univoque. Différentes méthodes existent, avec différents résultats.
Pour en finir avec les dinosaures et avant de rebondir sur d’autres questions, il me semble intéressant de confronter les réflexions de Patrick Peccatte à un fameux webcomics à base de dinosaures, Dinosaur comics. J’en rappelle brièvement le principe : tous les strips de ce webcomics (depuis 2003) utilisent strictement les mêmes images, sans cesse répétées, de trois dinosaures, auquel l’auteur ajoute des dialogues. L’humour nonsensique provient précisément de la façon dont ces images (un T-Rex agressif, un raptor en train d’attaquer) sont détournées de leur connotation visuelle initiale, mis en avant dans l’article de Peccatte. L’imagerie classique qui met en présence deux dinosaures et de les représenter en train de se battre, et non comme ici en train de disserter sur les homards, la meilleure console de jeu vidéo, ou l’automne. Dinosaur comics, par sa présence sur le Web, vient interroger le statut de l’image sur le réseau, à l’heure des mèmes, ces images reproduites en masse dans un espace de publication dont la répétition, la reproduction, la réutilisation et le lien sont des mécanismes. Le contexte numérique reproduit à une échelle nouvelle les principes de réutilisation des images mis en évidence dans les pulps et les comics, il en fait presque un principe de base de la circulation des images. Là intervient tout le génie de Dinosaur comic : parvenir à construire une narration uniquement à base d’images stéréotypées.
Pistes exploratoires : turbo-chose et culture médiatique contemporaine
Pour terminer ce billet, je vais y aller de ma modeste contribution à cette question en lançant une piste potentielle à qui veut bien la saisir. Car cette question de la réappropriation des images par la bande dessinée m’intéresse beaucoup. C’était en partie l’angle que j’avais choisi pour évoquer la revue Laudanum dont l’une des qualités était de réutiliser, soit par le collage, soit par la copie et l’imitation, des images du XIXe siècle. Mais ce n’est pas le XIXe siècle dont je vais parler, plutôt du XXIe siècle.
Et à ce stade (enfin, se disent ceux d’entre vous qui viennent sur mon blog pour entendre parler de bande dessinée numérique), j’en reviens à ma préoccupation du moment : l’incroyable essor du Turbomedia depuis 2009, dont j’avais parlé dans une précédente tournée mensuelle. Depuis le temps que je lis et vois passer ces Turbomedia, je me dis que leur succès n’est pas uniquement lié au dynamisme de Balak, Malec, Mast, Geoffo et toute l’équipe. Il y a quelque chose dans leur esthétique qui joue également. Et ce quelque chose a à voir avec la façon dont le Turbomedia capte, à la fois dans sa forme et dans ses thèmes récurrents, les dynamiques de la culture visuelle contemporaine.
Si je commence par les thèmes, il y a ce constat : la plupart des dessinateurs se revendiquant explicitement du Turbomedia partagent une culture commune qui mêle les influences des comic books américains et de l’esthétique visuelle des anime et manga japonais. La « culture visuelle » de ces auteurs est constituée par le fonds de la pop culture internationale des années 2000 et 2010, à base d’exaltation d’une culture « geek » commune, de jeux vidéos, de quêtes initiatiques, d’univers d’anticipation… Cet imaginaire partagé, dont je ne décris ici que quelques élément (on pourrait y ajouter le cinéma hollywoodien de ces dernières décennies, la science-fiction spatiale, de super-héros) est l’un des fondements de la stabilité du mouvement « Turbomedia ». Il y a une véritable cohérence thématique dans les imaginaires invoqués par cette forme de bande dessinée numérique.

Game Strip, de Game B (2010) : les débuts du Turbomedia très marquée par une synthèse des cultures médiatiques contemporaines.
Côté forme le recours à la notion de culture visuelle est tout aussi intéressant. Si on conçoit le Turbomedia comme une rencontre entre la bande dessinée et l’animation graphique, on se rend assez vite qu’il est la traduction concrète du dialogue que la bande dessinée, le cinéma, et le jeu vidéo entretiennent depuis les années 1990. Or, ce dialogue est particulièrement actif au sein des cultures nord-américaines et japonaises. Plus que chez nous, la notion de « transmedia » y est devenu un lieu commun. Il y a une continuité très forte et systématique entre les créations des différents médias : Dragon Ball est à la fois et à égalité une bande dessinée, un dessin animé, un jeu vidéo. Même chose dans la stratégie de l’éditeur Marvel qui devient de plus en plus un créateur multimédia. Les générations actuelles d’adolescents vivent sans doute beaucoup moins la séparation et la hiérarchisation des médias que les générations antérieures.
Les auteurs de Turbomedia, comme s’ils avaient pris en acte de la porosité des frontières éditoriales entre les médias, ont su s’approprier au bon moment la nouvelle culture populaire multimédia du XXIe siècle pour proposer une forme de narration qui l’exprime à merveille. L’amateur de manga, qui apprécie simultanément les films, les livres et les jeux vidéos, retrouvent dans certains Turbomedia des éléments formels relevant de ces trois médias.
La réflexion ci-dessus n’est qu’une hypothèse qui mériterait d’être approfondie et nuancée. Et j’ignore sans doute beaucoup de ce qui s’écrit sur les dialogues entre jeu vidéo et bande dessinée, sur la transmédialité, etc… Elle pourrait être précisée en combinant l’approche « par l’auteur » de Genoudet (interroger les auteurs pour comprendre leur mécanique d’appropriation d’un imaginaire contemporain) et par la masse (mettre en relation la masse des Turbomedia produits en six ans pour déceler les correspondants visuelles). Mais il me semble que l’essor du Turbomedia cristallise beaucoup de choses sur notre culture visuelle contemporaine et sur sa reconfiguration à l’heure du numérique.