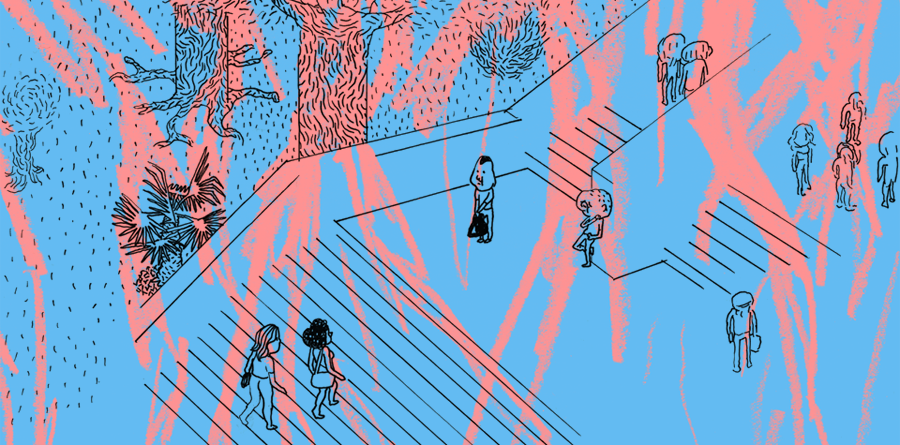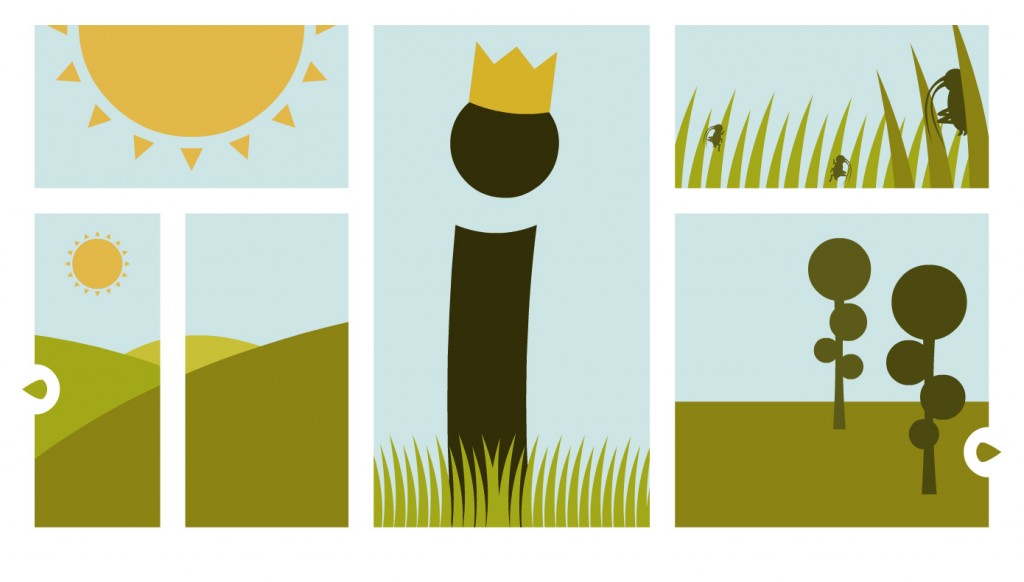Après cette petite pause estivale impromptue, Phylacterium est de retour pour vous présenter quelques bandes dessinées numériques de ces dernières années qui ont échappé à ma vigilance de tous les instants.
L’excellent colloque « Poétiques de l’algorithme » m’aura en effet permis de découvrir plus en détail trois oeuvres expérimentales et passionnantes, propres à faire évoluer nos conceptions de la création numérique…
Yannis La Macchia, Racontars, 2012
J’ai d’abord eu l’occasion de rencontrer Yannis La Macchia, auteur et éditeur de bandes dessinées suisse (éditions Hécatombe). A son palmarès se trouve notamment le prix de la BD alternative (sorte de prix du fanzine) en 2014 pour Un fanzine carré, sorte d’expérience créative où chaque numéro a comme contrainte d’être au format carré.
Comme il a eu l’occasion de l’expliquer lors de sa présentation, les deux moteurs du travail de Yannis La Macchia sont l’auto-édition (le principe des éditions Hécatombe n’est pas tant d’être une maison d’édition qu’une structure aidant les auteurs à s’éditer eux-mêmes) et l’expérimentation formelle, voire matérielle. Ses oeuvres, comme celles qu’il édite, sont à chaque fois singulières. Il n’y a qu’à considérer la présentation du numéro C du Fanzine Carré (2013) : « Un cube de 9 cm d’arête dont chaque face est une couverture. 999 livres qui se différencient les uns des autres par leurs impressions extérieures, composées de 99 dessins et de 6 glyphes qui s’associent et se dissocient selon un algorithme précis pour composer un ensemble de 999 livres uniques. ». Cette façon de jouer avec la matérialité des objets-livres réalisés, de la transformer en une composante même de l’oeuvre, n’est pas neuve, et a déjà eu l’occasion, au fil de l’histoire récente de la bande dessinée, de donner lieu à des créations singulières. Je pense bien sûr aux jeux de l’OuBaPo, mais aussi, plus récemment, à certaines créations publiées par les éditions Polystyrène et Rutabaga. Si vous êtes passionné par l’exploration des potentialités matérielles du « livre » de bande dessinée, je vous invite à aller voir ces divers éditeurs.
Mais revenons-en à Yannis La Macchia… Ce qui est d’autant plus passionnant dans son cas, c’est que cette tendance à interroger la « fabrication » même de l’oeuvre comme objet, il a su la transposer dans ses créations numériques. L’un des exemples est Racontars, un projet lancé à partir de 2012 et qui existe actuellement sous la forme d’une « saison 0 », en attendant l’hypothétique première saison. Plusieurs principes de la création numérique sont ici invoqués.
Le point de départ est l’aspect participatif de l’oeuvre : le contenu narratif même n’est pas imaginé par l’auteur, mais vient d’anecdotes déposées par formulaires par les internautes à cette adresse, réinterprétées ensuite graphiquement.
La seconde caractéristique est l’absence de linéarité d’une narration par embranchement. A partir de ce matériau narratif de base (les anecdotes réinterprétées), Yannis La Macchia a réalisé 50 histoires, qui mettent en scène quatre personnages de leur enfance à l’âge adulte (Mick, Padi, Mimi et Ella), pouvant se lire dans n’importe quel ordre. La lecture de chaque histoire courte invite à rebondir sur une suite, sur un autre thème, un autre personnage, une autre époque, bref un autre embranchement qui permet de vivre, à chaque visualisation de l’oeuvre, une expérience de lecture toute différente. Pour qui accepte de se laisser porter par une histoire allant souvent à l’encontre de nos habitudes traditionnelles de lecture, et portée par un style graphique faussement maladroit, Racontars est une expérience des plus singulières comme seul le numérique le permet, d’abord anecdotique, puis rapidement, en s’enfonçant dans l’enchevêtrement des histoires, de plus en plus profonde, renvoyant au fonctionnement erratique de mémoires et d’existences amoureuses à rebondissements.
Parmi les autres projets numériques de Yannis La Macchia a été évoqué lors du colloque de Liège l’écriture en cours d’un récit « algorithmique » mêlant édition numérique et édition papier : à partir d’un nombre de pages déterminé a été réalisé 1700 possibilités de récits, comme autant de livres numérique dont la moitié seront diffusés en librairie et l’autre moitié mis en ligne sur le web.
Daniel Merlin Goodbrey, The Empty Kingdom, 2014
Passons ensuite à ce qui constitue sans doute mon plus important rattrapage : la découverte de l’oeuvre du britannique Daniel Merlin Goodbrey. Lui aussi était invité au colloque de Liège pour parler de son travail. Son intervention a consisté à présenter une sorte de vade mecum de la création d’une bande dessinée numérique qui tournait autour de la question du « choix » : quels choix se présentent à un auteur souhaitant créer en numérique, à la fois sur le plan technique et économique, en fonction des différentes finalités de son oeuvre ? Utilisation de la « page » ou de la « toile infinie » ? Format spécifique à un outil de lecture ou format générique ? Utilisation ou non de flash ? Sous un habillage très pragmatique, l’auteur démontrait brillamment toute la diversité de la bande dessinée numérique.
S’il sait parler aussi bien de la complexité des choix de création numérique, c’est que Daniel Merlin Goodbrey la pratique depuis plus d’une quinzaine d’années. Parmi ses premières oeuvres mêlant « bande dessinée et hyperfiction », on pourra consulter Happyfrictions (2000) ou encore le webcomics Mr Nile Experiment (2003). Bref, un vétéran du numérique qui a souvent poussé ce type de création dans ses retranchements, loin des étiquettes, s’aventurant à la frontière entre la bande dessinée, les arts et la littérature numérique, ou encore le jeu vidéo. Surtout, il mêle la pratique à la théorie puisque, parallèlement à ses créations, il écrit et enseigne sur l’art numérique à l’Université de Hertfordshire et prépare une thèse sur la bande dessinée numérique.
S’il me fallait choisir une oeuvre parmi l’impressionnant nombre de créations de Daniel Merlin Goodbrey, je pencherai pour The Empty Kingdom. Cet « hypercomic », pour reprendre le terme de l’auteur lui-même raconte l’aventure d’un roi se promenant dans son royaume vidé de tout habitant (par un monstre cyclopéen, par un sorcier maléfique ?), comme une errance dont le but échappe d’abord au lecteur, avant de se révéler. Par bien des aspects, The Empty Kingdom emprunte au jeu vidéo (sans parler de sa diffusion sur Kongregate, la plateforme de jeux en ligne) : le lecteur est actif en ce qu’il peut diriger le roi à travers les paysages, et l’amener à se saisir et utiliser différents objets (une lampe, un avion en papier, un parapluie), dans une interface proche de celui d’un point and click d’aventures. Le lecteur a ainsi un parcours à réaliser pour faire avancer l’histoire. Mais dans le même temps, la bande dessinée n’est pas loin, dans la forme même de l’oeuvre, puisque c’est bien à travers des cases et des planches de bande dessinée que le roi se promène, des cases certes désertées mais souvent garnies de détails sur lesquels, au-delà du cheminement royal, le lecteur peut aussi s’arrêter, surprenant ici une troupe de dinosaures, là quelque peinture rupestre. A ce stade il est bien inutile de se demander si on regarde/lit/joue à un jeu vidéo ou à une bande dessinée. L’essentiel est encore de se plonger dans une oeuvre atypique qui a le mérite de ne pas être une simple démonstration et d’égrener, au fil d’une douce bande-son, d’un humour délicat et d’un graphisme minimalisme, une forme modeste de poésie.
Dennis Cooper, Zac’s Haunted House, 2015
Pour mon dernier « rattrapage », il ne s’agit pas d’un auteur présent au colloque mais d’un auteur présenté et analysé par Estelle Dalleu à cette occasion : Dennis Cooper. On aurait d’ailleurs bien tort de définir Dennis Cooper comme un auteur de bande dessinée : il est connu comme un écrivain américain actif dès les années 1970, proche du mouvement punk et porteur d’une littérature fondamentalement subversive. Je ne connaissais absolument pas cet écrivain avant la présentation d’Estelle Dalleu qui a choisi de s’intéresser à deux de ses oeuvres relevant des arts numériques, Zac’s Control Panel et Zac’s Haunted House.
La singularité de ces deux créations, au coeur de cette présentation, est d’être composées uniquement d’une suite de GIF animés récupérés sur le Web. Faire oeuvre à partir de GIF, production du Web « impure » s’il en est, est déjà en soi un choix audacieux. C’est opter pour un matériau de base bien souvent considéré comme laid, déjà démodé à l’échelle du réseau Internet, kitsch, marqueur d’une infographie techniquement limitée et visuellement rétro, ancrée dans les années 1990. Mais créer en GIF au milieu des années 2010, c’est aussi participer à une forme de revival de ce format, devenu de plus en plus populaire à l’heure des mèmes Internet et de twitter, qui en fait un grand usage. Côté bande dessinée, on s’intéressera notamment au travail de l’Atelier Capsule qui redonne au GIF un certaine modernité graphique. De fait, ce format est régulièrement autorisé dans des créations souhaitant jouer sur le principe de courtes boucles d’animation.
Mais Zac’s Haunted House et sa suite Zac’s Control Panel ne sont pas à proprement parler des bandes dessinées. Ils sont présentés comme des romans numériques, et de fait la navigation en leur sein se fait à travers un système de chapitrage.
Il est parfois difficile de dire ce que racontent réellement ces deux histoires faites par collage de séquences animées, et jouant sur des effets finalement primitifs d’analogies, de raccords, de montage, qui renvoient, pour reprendre l’analyse d’Estelle Dalleu, aux oeuvres pré-cinématographiques. Tous deux sont des plongées, parfois cauchemardesques, souvent ironiques, dans l’imaginaire visuel de notre pop culture (on y croise extraits de films et de jeux vidéos), et c’est au spectateur de se forger sa propre histoire, en fonction de ses propres références. L’effet est souvent sidérant, violent, imprévisible, dérangeant.
Il n’est bien sûr pas question ici de bandes dessinées et, si les oeuvres de Dennis Cooper étaient à rapprocher d’un genre, ce serait bien davantage du roman-photo. Néanmoins, la présentation de ces deux oeuvres, dont j’invite mes lecteurs à faire l’expérience, m’a inspiré deux réflexions.
La première tient à l’usage du GIF animé dans la bande dessinée numérique. Au-delà de son ancrage très fort dans une époque précise, le GIF s’avère être un outil extrêmement riche, extrêmement maniable et léger pour créer des oeuvres séquentielles. Car après tout Zac’s Control Panel et Zac’s Haunted House sont bien fondamentalement séquentiels, et d’une séquentialité plus proche de celle de la bande dessinée imprimée que du cinéma en ce que le lecteur visualise plusieurs images en même temps. Ici, la séquentialité prend la forme d’un défilement vertical (là encore une forme devenue courante dans la bande dessinée numérique), mais on pourrait aussi bien imaginer une suite de GIF en diaporama. Bref, il y a de quoi explorer dans cette direction.
L’autre réflexion tient à la question des frontières. J’en parlais déjà avec Daniel Merlin Goodbrey : il n’est plus temps, me semble-t-il, de savoir ce qui relève de la bande dessinée numérique, de la littérature numérique, du jeu vidéo… Mais bien plus tôt, il nous faut accepter (et par nous j’entends les lecteurs comme les créateurs) un brouillage des frontières que le numérique accentue. Les créations de Dennis Cooper le montrent : il y a beaucoup à aller voir du côté des arts numériques et de la littérature numérique, qui disposent d’une histoire vieille de plus de vingt ans, pour faire avancer la création purement graphique avec de nouvelles idées qui sont, en réalité, le rattrapage d’idées anciennes. Accepter d’aller voir ailleurs et de se passer des catégories est une voie d’avenir pour la bande dessinée numérique.